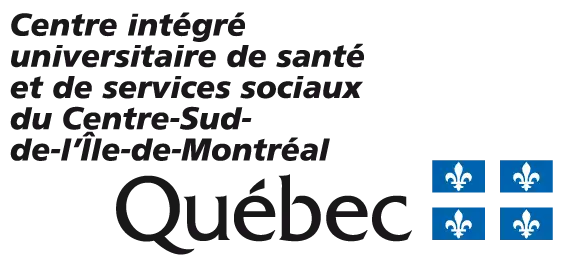Formulaire d’évaluation du chapitre
Formulaire d’évaluation du chapitre
Formulaire d’évaluation du chapitre
Formulaire d’évaluation du chapitre
Le mandat judiciaire
Un époux peut également demander un mandat judiciaire par lequel il pourra administrer les biens de son conjoint qui ne peut le faire. Il peut s’agir des biens que le conjoint administre en vertu de leur régime matrimonial ou encore des biens propres du conjoint. Le tribunal établit les modalités et conditions d’exercice de l’administration (444 C.c.Q.).
L’autorisation du tribunal
Un époux peut, par ailleurs, demander l’autorisation du tribunal pour effectuer seul un acte auquel le consentement de son conjoint est habituellement nécessaire, comme la vente d’un bien (399 C.c.Q.). Cette mesure spéciale est évidemment limitée dans le temps.
Le mandat domestique
Le mandat domestique découle d’une responsabilité établie par les liens du mariage. Ainsi, bien que chaque époux puisse donner un mandat spécifique à l’autre pour des actes relatifs à la famille, ce mandat est présumé (398 C.c.Q.) lorsque l’un d’eux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, comme dans le cas du majeur inapte. Le conjoint de la personne inapte peut donc « se charger, en son nom, des besoins familiaux courants et des nécessités imprévues (aliments, soins médicaux, frais de logement, meubles, électricité, chauffage, etc.) ». Cette mesure ne nécessite donc pas l‘intervention d’un tribunal.
Des mesures destinées aux conjoints
Certaines mesures permettant d’éviter l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation du mandat concernent les conjoints mariés ou unis civilement seulement. Les conjoints de fait ne peuvent recourir à ces moyens.
Le devenir du régime de conseiller au majeur
Étant catégorisé comme régime de protection, le régime de conseiller au majeur exigeait une démarche légale, incluant les évaluations médicale et psychosociale. La personne nommée à titre de conseiller n’était pas pour autant reconnue comme représentant légal. Son rôle consistait strictement à aider ou conseiller le majeur dans la gestion de son patrimoine. Aussi contrairement au curateur, le conseiller au majeur n’acquiert pas le rôle de tuteur au 1er novembre 2022.
Le rôle qui lui a été dévolu antérieurement par jugement se poursuit au-delà de cette date, avec les mêmes pouvoirs et obligations. Si la réévaluation prévue (le délai de réévaluation du régime de conseiller au majeur était fixé à trois ans, sauf si le tribunal en décidait autrement) démontre des inaptitudes dans les domaines de la « Protection de la personne » et de l’« Administration des biens », les nouvelles normes s’appliquent et un tuteur pourrait lui être nommé. Si le majeur ne démontre pas d’inaptitude et qu’il souhaite une aide, une demande d’assistance au majeur pourrait être adressée au curateur public.
La conversion du régime de curatelle en tutelle
Le rapport du curateur public Statistiques sur les personnes bénéficiant de mesures de protection du 31 mars 2022 révèle que plus de 12000 personnes sont sur un régime de curatelle, privé ou publique. Un régime de curatelle était ouvert lorsque l’inaptitude de la personne s’avérait totale et permanente. Au 1er novembre 2022, les curatelles actuelles ont été automatiquement transformées en tutelle et la fonction de curateur remplacée par celle de tuteur.
Nonobstant cette conversion, les tuteurs continuent de représenter le majeur pour les actes autorisés lors de l’ouverture du régime de curatelle jusqu’à ce que la tutelle soit modifiée par jugement ou par constat du tribunal. Les changements nécessaires au niveau de la représentation seront envisagés à la lumière des réévaluations médicale et psychosociale qui seront faites aux dates déjà prévues dans le dossier du majeur. Le tribunal décidera des actes que le majeur peut faire seul ou non. De même, la modulation de la tutelle tiendra compte des facultés de la personne. Pour la plupart, aucun changement dans le rôle du tuteur ne surviendra si l’évaluation médicale de l’aptitude corrobore l’atteinte totale et permanente des fonctions cognitives. Seul le montant des transactions financières que le tuteur peut envisager au nom du majeur inapte a fait l’objet d’un ajustement (289.1 C.c.Q.)
Par ailleurs, aux droits pérennes des personnes sous curatelle :
- exercer leur autorité parentale;
- consentir à leurs soins (si, au moment du soin, elles sont aptes à y consentir);
- voter lors d’une élection fédérale;
- donner un cadeau d’usage ou un bien de peu de valeur.
pourront s’ajouter dorénavant ceux reconnus aux personnes sous tutelle :
- voter lors des élections provinciales, municipales et scolaires;
- faire leur testament, sous réserve qu’il soit confirmé par le tribunal;
- administrer un organisme sans but lucratif.
Les actes juridiques posés par la personne inapte
Avant l’ouverture de la tutelle au majeur
En ce qui concerne les actes ayant une portée juridique effectués avant le jugement qui a conduit à la mise en tutelle, il faut la preuve que l’inaptitude du majeur était notoire ou connue du cocontractant au moment où l’acte a été passé pour annuler cet acte ou réduire les obligations (290, voir aussi 1392 C.c.Q.).
Après l’ouverture de la tutelle
Par l’ouverture de la tutelle au majeur, celui-ci perd l’exercice de certains droits civils selon la nature de la tutelle et certains actes juridique lui sont interdits par le jugement. Qu’arrive-t-il si le majeur sous tutelle effectue seul un acte non autorisé, par exemple s’il fait un emprunt considérable ou vend sa maison ?
Dans le cadre de la tutelle au majeur, les questions relatives à l’exercice de ses droits civils suivent les règles qui s’appliquent au mineur (287 C.c.Q.). S’il s’agit d’un acte non autorisé par le jugement, l’acte peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice. S’il s’agit d’actes en dehors de ceux qui étaient exclus, l’acte peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites seulement si le majeur en subit un préjudice (174 C.c.Q.).
Le rôle du curateur public en tant que tuteur au majeur
Le régime de protection public est une démarche de dernier recours ; le régime de protection privé doit être privilégié. Le curateur public doit être nommé par le tribunal pour agir comme tuteur lorsque le majeur est isolé ou que les proches refusent ou ne peuvent assumer ce rôle. Il peut aussi agir dans le cadre de la tutelle au majeur si celui-ci est provisoirement dépourvu d’un tuteur. Il a l’obligation de rechercher un tuteur privé lorsqu’il exerce ces fonctions.
La nature de la tutelle confiée au curateur public peut être de même nature que la tutelle privée, soit à la personne ou aux biens ou mixte. De même, le rôle du curateur public comme représentant légal ne diffère pas de celui du tuteur privé (256 C.c.Q.). Il doit assurer la protection de la personne, l’administration de son patrimoine et l’exercice de ses droits civils en fonction de la charge et des obligations émises dans le jugement. Comme tuteur aux biens, il a également la simple administration des biens des majeurs protégés. (Pour plus de détails, consulter les sections Implication du Curateur public dans les tutelles publiques et Gestion du patrimoine d’une personne représentée par le Curateur public.)
Par ailleurs, outre son rôle de tuteur, le curateur public détient un rôle d’assistance auprès des conseils de tutelle et de surveillance des régimes privés de protection (tutelle). (Sur le rôle du curateur public à l’égard des tutelles privées, consulter le site Implication du Curateur public dans les tutelles privées.) Il possède également un pouvoir d’enquête en cas de situation d’abus et peut réclamer la destitution du tuteur devant le tribunal si la situation le réclame. (Pour plus de détails sur la nature et le signalement des cas d’abus, consulter En cas d’abus dans une tutelle au majeur.)
Le curateur public peut dans des cas exceptionnels recourir à des mesures de protection provisoires (gestion d’affaires ou autorisation du tribunal) pour assurer la protection ou gérer provisoirement les biens d’une personne inapte sans protection juridique (mais seulement si une demande d’ouverture d’une tutelle est en cours ou imminente). Cela exige que l’inaptitude de la personne ait été établie, qu’il existe une situation de préjudice (la gravité du risque est prise en compte), par exemple pour le paiement des taxes foncières d’une personne sans régime de protection qui risque de perdre son immeuble, et que la personne est isolée.
Lors du signalement d’un cas d’abus à l’égard d’une personne inapte sans mesure de représentation, le curateur public ne peut exercer les pouvoirs précédemment décrits ; il peut cependant orienter le proche vers les ressources appropriées. (Pour plus de détails, consulter Intervention du Curateur public auprès de personnes inaptes sans représentation légale.)
Comme représentant légal, le curateur public, via la Direction médicale et du consentement aux soins, donne le consentement aux soins (formulaire de Consentement à un soin) lorsque le majeur sous sa garde est inapte à consentir à ce soin. La Direction médicale consent également aux demandes concernant un niveau de soins, une mesure de contrôle, l’accès au dossier d’une personne représentée. Par ailleurs, le clinicien doit s’adresser à la direction territoriale où réside la personne inapte pour une demande de consentement à l’hébergement et à la communication de renseignements, ainsi qu’à une demande de consentement à la captation et à l’utilisation de son image ou de sa voix.
Enfin, le curateur public peut également donner le consentement aux soins, pour le majeur isolé et non représenté, inapte à consentir aux soins et qui a besoin d’être protégé. Par exemple, un majeur inapte non représenté et sans aucun proche nécessite une intervention chirurgicale non urgente. La Direction médicale peut être contactée pour obtenir le consentement à la chirurgie. Elle devra alors, comme tout autre représentant légal, obtenir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur les soins proposés.